Aujourd’hui, la plus grande nouvelle vient d’Azerbaïdjan.
Ici, l’Azerbaïdjan défie ouvertement l’influence de la Russie, démantelant les liens culturels et arrêtant des journalistes russes dans ce qu’il qualifie de répression contre l’ingérence étrangère. Autrefois partenaire proche du Kremlin, Bakou se présente désormais comme un acteur régional qui n’est plus prêt à tolérer ce qu’il considère comme une manipulation russe, signalant un changement plus profond qui pourrait redessiner les alliances dans l’espace post-soviétique.

Les récentes décisions de l’Azerbaïdjan équivalent à une rupture politique totale. Les événements culturels russes à Bakou ont été annulés. Une visite prévue du vice-ministre russe de la Culture a été brutalement annulée. Sept journalistes russes, pour la plupart employés par Sputnik et Ruptly, ont été arrêtés et accusés d’agir comme agents étrangers.


Selon les responsables azerbaïdjanais, ces individus recueillaient des renseignements ou façonnaient des récits au service des intérêts du Kremlin.

La Russie nie ces accusations, affirmant qu’il s’agissait de journalistes légitimes, mais cet affrontement ne sort pas de nulle part. La police russe a récemment mené des descentes dans des entreprises et marchés tenus par des Azerbaïdjanais à Iekaterinbourg, Voronej et dans d’autres villes, les forces de l’ordre russes qualifiant ces actions de lutte attendue contre les réseaux criminels ethniques.


Peu après, plusieurs détenus azerbaïdjanais sont morts en garde à vue en Russie, officiellement à la suite d’insuffisances cardiaques ou d’embolies, bien que les médias azerbaïdjanais et les familles des victimes aient accusé la police russe de torture.

Mais il ne s’agit pas seulement des morts eux-mêmes ; c’est ce qu’ils symbolisent. Pour l’Azerbaïdjan, ce fut la goutte d’eau qui a fait déborder le vase, un prétexte pour accélérer une rupture qui se préparait depuis longtemps. La réponse a été rapide et publique. La télévision d’État azerbaïdjanaise a diffusé des segments comparant Vladimir Poutine à Staline, un message repris sur les réseaux sociaux, dans les déclarations officielles et dans les commentaires culturels. Les arrestations de journalistes de Sputnik n’étaient pas simplement des représailles ; elles étaient un signal que Bakou ne considère plus l’influence des médias russes comme acceptable. Que ces journalistes aient été ou non des espions, leur licence d’exploitation avait déjà été révoquée depuis février, l’Azerbaïdjan cherchant activement à reprendre le contrôle de son espace narratif. La présence des médias d’État russes a longtemps façonné l’opinion publique et influencé les résultats électoraux dans les pays voisins, rendant leur expulsion non seulement symbolique mais aussi stratégiquement significative pour Bakou. Les responsables russes ont qualifié cette répression de forme de génocide et l’ont présentée comme une expression de russophobie, reprenant les récits habituels du Kremlin qui dépeignent toute résistance à l’influence russe comme une persécution ethnique ou culturelle.

Ce revirement radical s’inscrit dans une dynamique de fond : depuis des années, l’Azerbaïdjan se tourne vers l’Ouest. Il achète du matériel militaire à la Turquie et à d’autres fournisseurs liés à l’OTAN. Il a mené la guerre de 2020 au Haut-Karabakh contre l’ancien allié de la Russie, l’Arménie, et son offensive de 2023 a encore repoussé les limites de la capacité de Moscou à intervenir dans le Caucase du Sud. Et il ne s’agit pas uniquement de mouvements militaires ; Bakou a aussi discrètement tissé des liens avec l’Ukraine, lui fournissant du carburant et, par l’intermédiaire de tiers, des armes. Pendant les descentes de police russes et la réponse azerbaïdjanaise, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a même appelé son homologue azerbaïdjanais, Ilham Aliyev, pour exprimer son soutien face à l’ingérence russe en Azerbaïdjan.

Ce fut un petit geste, mais aux implications majeures : Kyiv considère Bakou comme un partenaire dans l’effort visant à affaiblir la mainmise de la Russie sur ses voisins, pour permettre à des millions de personnes de choisir leur propre avenir.

La Russie semble dépassée : la guerre en Ukraine continue de mobiliser toute son attention, entraînant une érosion progressive de son influence géopolitique. En Asie centrale, dans le Caucase du Sud et même dans d’autres parties de l’Europe de l’Est, d’anciens alliés affirment de plus en plus leur propre voie. Les actions de l’Azerbaïdjan s’inscrivent dans cette dynamique plus large : il y a dix ans, défier ouvertement Moscou, cibler ses récits et rejeter sa diplomatie culturelle aurait été impensable ; aujourd’hui, cela devient une forme de légitime défense.

Avec le président américain Donald Trump ayant récemment révélé que les ambitions territoriales russes s’étendent bien au-delà de l’Ukraine, la décision de l’Azerbaïdjan de rompre dès maintenant est préventive. Notamment, les médias russes remettent déjà en question la légitimité de l’État azerbaïdjanais et tentent de nourrir les tensions ethniques parmi les minorités du pays. Si la guerre en Ukraine devait se terminer, la Russie chercherait probablement à s’affirmer ailleurs ; pour l’Azerbaïdjan, tracer une ligne rouge dès maintenant revient à dire : nous ne serons pas la prochaine cible.

Dans l’ensemble, le tournant spectaculaire de l’Azerbaïdjan contre la Russie marque bien plus qu’une simple querelle diplomatique. Il s’agit d’une rupture révélatrice de courants régionaux profonds, où la domination de Moscou n’est plus une évidence, et où les anciens alliés ne se taisent plus. Ce qui a commencé comme une enquête criminelle s’est transformé en une confrontation autour de la souveraineté, du contrôle de l’information et du droit de l’Azerbaïdjan à définir seul sa politique intérieure.



.jpg)
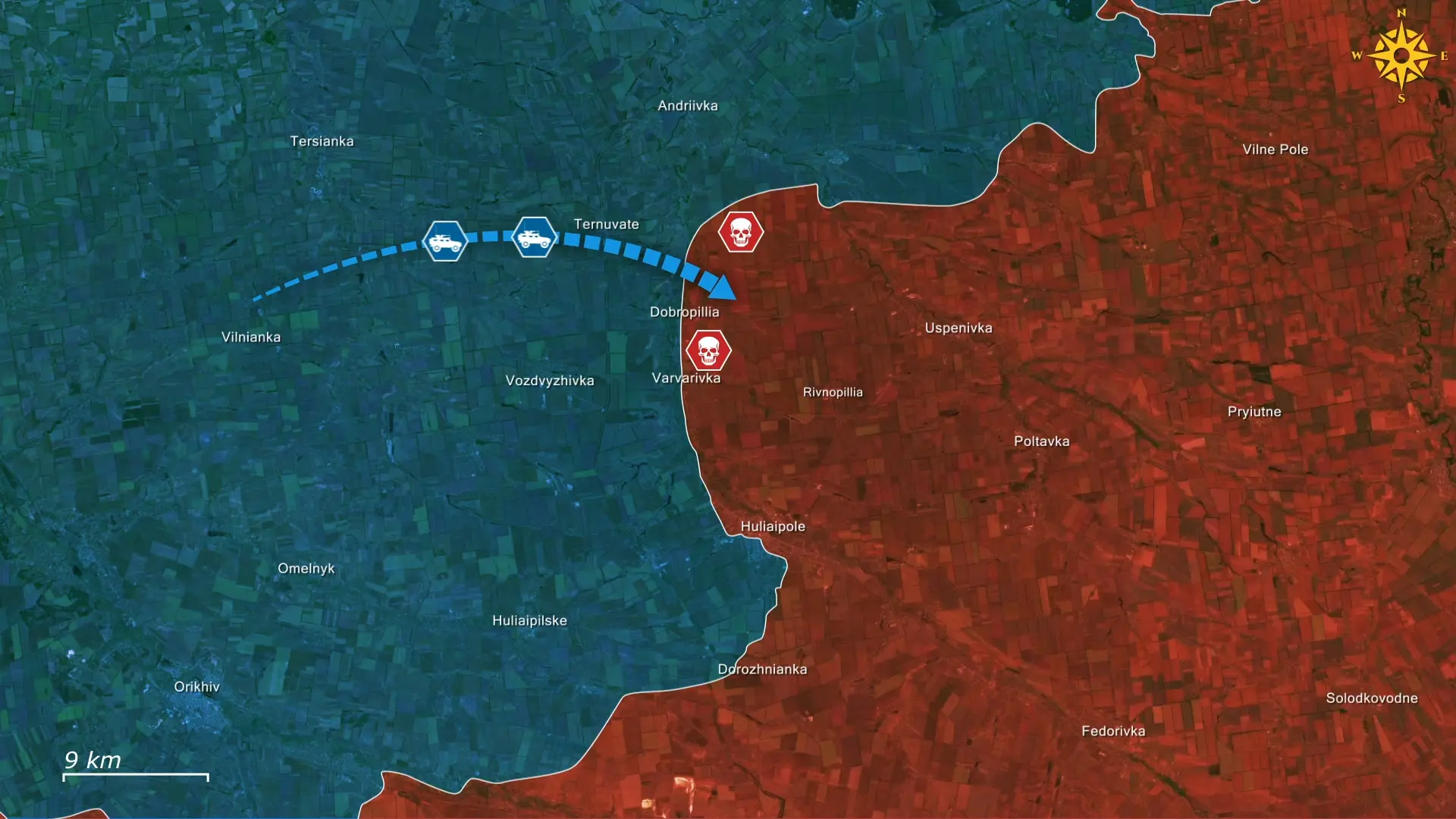

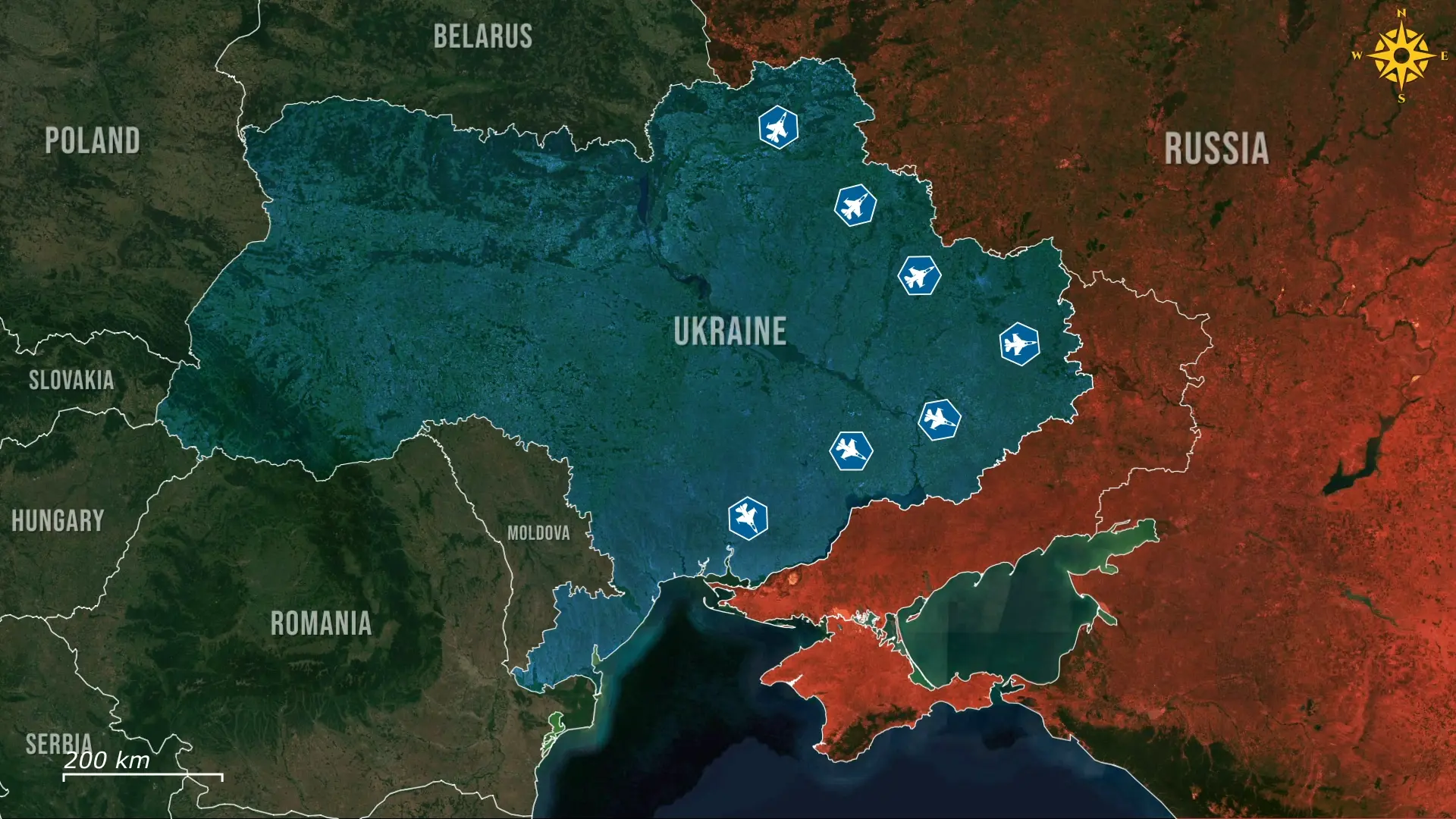
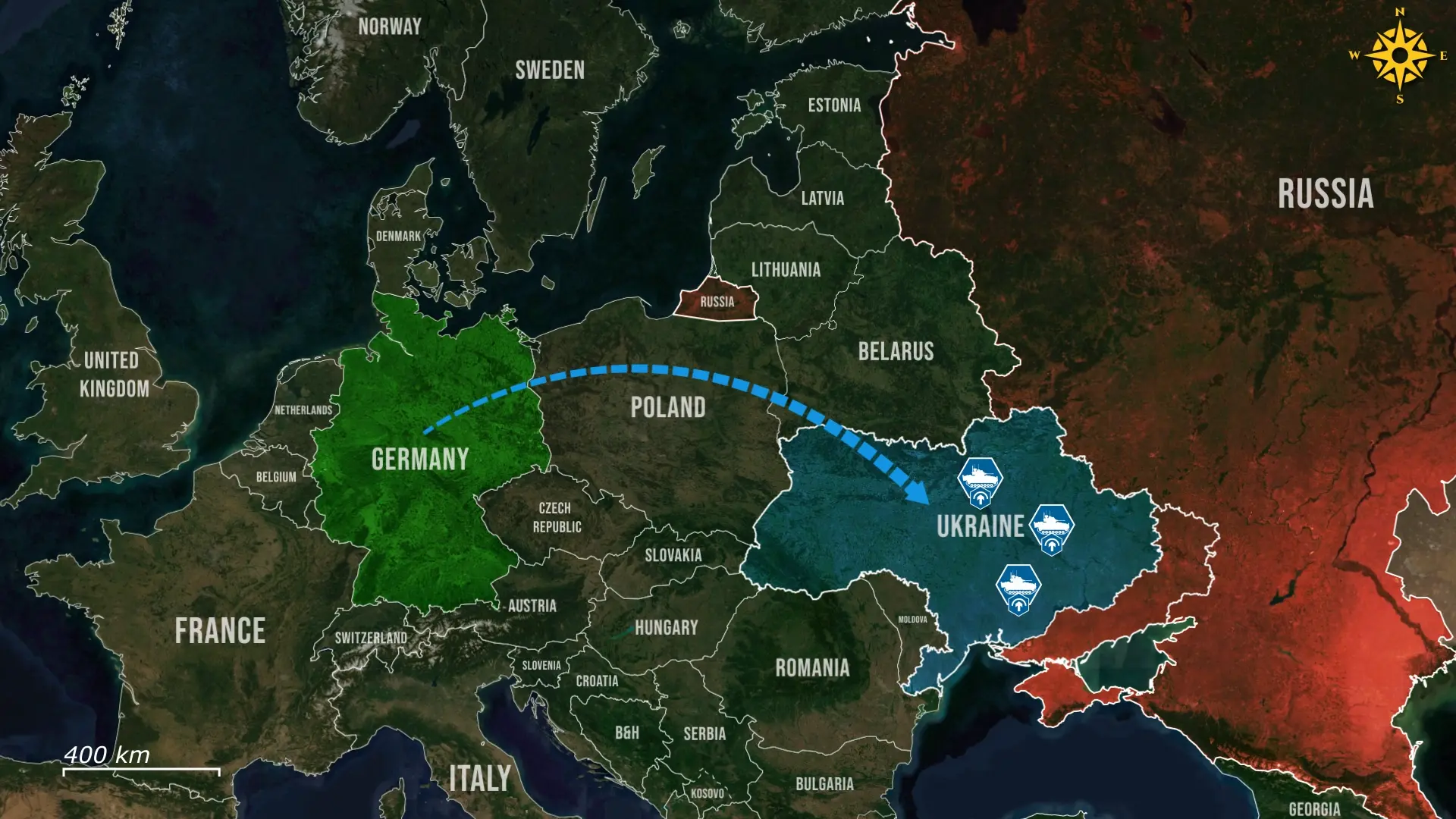



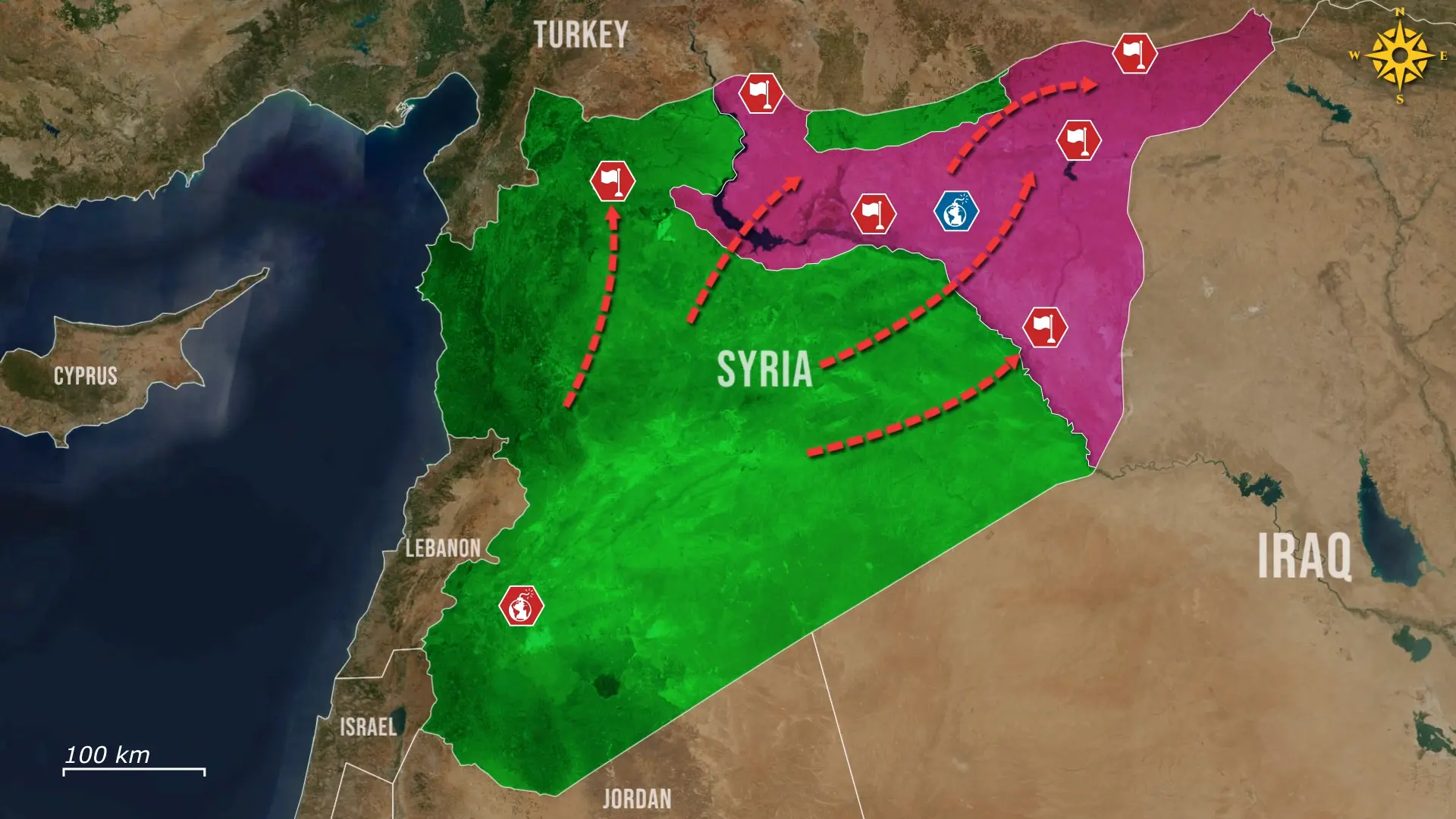
Commentaires